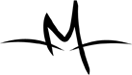Hervé POUZOULLIC, m’a fait l’amitié de me proposer une de ses nouvelles… pour vous !
Vasilissa saute sur notre canapé.
Elle saute si bien, les deux pieds à l’horizontale et la tête dans les étoiles !
Elle a commencé à le faire à l’âge de deux ans sur le lit de sa grand-mère, à Tver, en Russie, à cent soixante kilomètres de Moscou.
Tous les week-ends, sa maman quittait la capitale, où elle travaillait, pour venir la rejoindre,
et Vasilissa était heureuse de la retrouver. Depuis, elle n’a jamais cessé de sauter. Pour moi, c’est nouveau. Je ne sais pas m’y prendre ;
je suis plutôt du genre à me cogner au plafond ou à traverser le sommier. J’adore ce moment où elle m’invite à la rejoindre :
ses bras s’ouvrent, son sourire s’élargit. Son bonheur m’intimide. Elle me tend les mains, je me laisse guider.
Ensemble, nous sommes si légers !
Aujourd’hui, nous fêtons notre installation dans un petit nid douillet de la rue Delambre.
— Bon, Marc, je suis fatiguée à présent… Mais on s’est bien amusés.
— On fait quoi maintenant ?
— Je ne peux pas vous aider. Je ne connais pas Paris aussi bien que Moscou.
— Allons à la Coupole. C’est le bon endroit pour célébrer notre première journée de vie à deux.
Le temps de s’habiller, et on dévale l’escalier Art déco en se tenant par la main. Son perfecto en cuir rouge donne à Vasilissa un air rebelle.
Sous ses pas fleurissent des coquelicots.
Niché dans sa chevelure blonde, je flotte à ses côtés.
On arrive à la fameuse brasserie. Je commande deux coupes de champagne et observe Vasilissa, plongée dans la lecture du menu.
C’est notre premier dîner en tête à tête depuis qu’elle a quitté la Russie. Nous allons désormais vivre ensemble, partager le quotidien…
Ce saut dans le connu m’effraie. L’effroi des réveils à la même heure et de la mauvaise haleine du matin.
La crainte du regard qui vous traverse sans vous voir. Quel amour peut résister à la présence de l’autre ?
Les escarres de mes expériences ratées se rouvrent. J’ai peur d’être heureux.
— Je vais prendre un filet de connard, annonce fièrement Vasilissa.
— Beaucoup de Parisiens vous serviront ce mets sur un plateau, mais il n’est pas à la carte ce soir, commente le serveur.
Vous faites sans doute référence au filet de canard ?
— Je prends comme Madame, dis-je.
Le garçon nous débarrasse des menus et s’évanouit dans le décor.
— Vasilissa, j’adore vos erreurs de français. Je ne les corrigerai jamais.
— Vous voulez que je m’intègre dans votre pays ou non ?
— Non. Nous fauterons ensemble.
Notre repas se poursuit tranquillement. Pour la première fois, les minutes filent en douceur. L’urgence de s’aimer a disparu.
— Marc, pourquoi m’avez-vous amenée ici pour notre première soirée ?
— Ma chérie, ce lieu est chargé d’histoire. Vous êtes assise à la place d’Elsa Triolet, le jour où elle fit la connaissance d’Aragon.
On leur doit parmi les plus beaux poèmes d’amour. Vous êtes ma muse, Vasilissa.
Je n’ai pas le talent d’Aragon, mais je ferai de mon mieux pour célébrer vos mains, vos pieds, vos yeux, vos tétons, vos fesses !
Soudain, la luminosité dans la salle diminue et le brouhaha des conversations retombe.
Dans la lueur d’une bougie posée sur un gâteau se dessine le visage de notre serveur, escorté de ses collègues.
Tous s’approchent de notre table et s’écrient en chœur : « Ici, c’est Paris ! » Vasilissa comprend que le gâteau lui est destiné.
Un sourire illumine son visage et la rend encore plus belle, mais dans ses yeux je vois l’ombre de ses peurs et la tristesse d’avoir quitté son pays.
Elle souffle la bougie.
Dans les applaudissements, elle croit entendre sa famille et ses amis, l’écho de leurs voix au loin, le son de leurs rires, ailleurs.
Elle aurait voulu tout retenir, ses rires de petite fille perdue dans l’immense édredon à plumes chez ses grands-parents,
ses promenades en forêt, les chants de sa Babou au matin. Elle cache son visage entre ses mains et ses larmes glissent sur ses joues,
emportant rimmel et souvenirs dans le fracas de la Moskova un jour de débâcle.
Il est temps de rejoindre nos amis au Rosebud, à quelques pâtés de maisons de là.
Devant la porte du bar se tient Bruno, fumant une cigarette. Coiffure à la Jeanne d’Arc, sourcils arrondis perchés sur un nez fin,
lèvre basse de ceux qui ont le verbe haut, Bruno a toujours eu l’esprit de contradiction :
il est devenu communiste après l’effondrement du bloc de l’Est, adorateur du capital après la crise financière de 2008, et finalement avocat.
Une créature asiatique aux cheveux courts l’accompagne et me fait face, bien campée sur ses jambes, bras croisés.
Elle me dévisage et la prédation de son regard me gêne. Son œil droit se met à défiler dans son orbite
comme le rouleau d’une machine à sous puis, à nouveau, ses deux yeux me fixent.
— Vasilissa, je vous présente Bruno, un dandy radical accro aux causes perdues.
— Vasilissa, vous êtes donc réelle ? On pensait que Marc s’était inventé une Anna Karénine et qu’il se rêvait en comte Vronski…
— Nous nous connaissons à peine et vous m’imaginez déjà finir sous un train ? s’étonne Vasilissa.
— Tu nous présentes ton amie ? demandé-je.
— Bien sûr. Voici Atsuko. On se connaît depuis trois jours. Elle participe à la Nuit des arts martiaux
et prolonge son séjour à Paris d’une semaine.
Atsuko nous tend une main dure comme la pierre.
— C’est quoi l’art martial que vous pratiquez ? interroge Vasilissa.
— La casse. Elle pratique la casse en karaté Kyokushinkai, répond Bruno. Atsuko casse quatre cents briques en moins d’une minute !
— Avec sa tête ? questionné-je.
— Non, avec ses poings, si j’ai bien tout compris, plaisante Bruno.
— François est arrivé ?
— Il est à l’intérieur. Il vient de se séparer d’Aurélie. Il se console dans les bras d’une de ses étudiantes, une Québécoise…
Bruno éteint sa cigarette et nous pénétrons au Rosebud. François a installé son fauteuil roulant et son amie canadienne au milieu de la salle.
J’aime cet homme, son intelligence, sa culture encyclopédique, son visage de hérisson, sa bienveillance et son amitié sincère.
Je l’ai rencontré à Sciences Po en même temps que Bruno. Depuis, nous sommes inséparables.
— Vasilissa ! Enfin ! s’exclame François en étreignant mon amie. Vous êtes magnifique. Et tout quitter pour l’amour d’un homme, c’est beau !
Je vous présente Charlotte. Charlotte est québécoise et suit mes cours en sciences sociales.
— Bonjour, Vasilissa. Bienvenue à Paris ! Quel beau pétard ! fait remarquer la jeune fille.
Son accent, sa voix et la liberté de ses vingt ans font trembler les murs ; son mètre soixante, ses escarpins rouges et ses yeux noirs rieurs aussi.
Elle porte une robe moulante qui remonte sur ses cuisses, comme un signe de sa bonne nature, et qu’elle rajuste sans cesse.
— Pétard ? s’étonne Vasilissa.
— Pétard signifie « belle fille » en québécois, explique François.
— Bon, il est temps de porter un toast et de souhaiter la bienvenue à Vasilissa, enchaîne Bruno.
Je passe la commande, faites-moi confiance pour les cocktails : un Sidecar pour François, un Singapour Sling pour Atsuko,
un Bloody Mary pour Charlotte, un French 75 pour Marc, un White Russian pour notre amie russe et un Orgasme pour moi.
Le garçon prend la commande et les cocktails arrivent rapidement. Je me lève.
— Vasilissa, en vous attendant à l’aéroport, j’ai eu envie de vous écrire.
Ne prêtez pas attention au papier, c’est un préavis de grève du personnel navigant, la seule feuille que j’ai trouvée sur place.
Bruno, François, on ne se moque pas, ok ? J’y vais ! « Vasilissa, votre présence à mes côtés relève du miracle.
Je bénis les vents d’Oural et de Sibérie. Ils se sont joués des montagnes, de la toundra, des forêts, des fleuves et nous ont réunis.
Vous m’avez vu au-dessus de la tour Eiffel ? Je vous attendais là-haut, niché dans une aquarelle de Raoul Dufy.
J’ai vu votre jeunesse vous porter, votre esprit libre flotter jusqu’à moi. J’ai vu votre âme me sourire quand vous vous êtes envolée de Moscou.
J’ai vu vos cheveux au vent déployés comme les ailes d’un ange. J’ai vu vos mains tendues vers les miennes.
J’ai vu nos doigts enlacés, nos lèvres soudées. Puis nous nous sommes posés dans notre petit appartement. »
Et ce soir, dis-je pour conclure, je vois la femme de ma vie !
— Trop fort ! On dirait une pub pour Aeroflot ! se gausse François.
— Marc sait chanter la pomme, commente Charlotte.
— Moi, j’aime beaucoup, déclare Vasilissa. Je garderai toujours votre lettre avec moi.
Une déclaration d’amour sur un préavis de grève… je suis en France.
Bruno fait le silence et lève son verre.
— Savez-vous ce que le tsar Alexandre Ier a écrit au peuple français en 1814, lorsque les troupes russes ont occupé Paris ?
— Non.
— « Les Français sont mes amis. » Camarade Vasilissa, nous nous rendons avec plaisir aux charmes d’une nouvelle invasion soviétique :
la vôtre ! Vous êtes désormais notre amie.
C’est alors que la scène bascule dans le drame. De la table voisine, occupée par trois hommes, fuse des remarques avinées.
— Nous, on n’aime pas les collabos !
— Ouais, et puis votre copine avec son œil bizarre, on dirait Sartre déguisé en Hong Kong Fou Fou.
Atsuko comprend qu’on se paie sa tête. Son œil se met à papilloter. Bruno tente à sa manière de calmer les choses :
— Vous ne le savez peut-être pas, mais Jean-Paul Sartre fréquentait cet établissement avec Simone de Beauvoir.
On trouve d’ailleurs, de l’autre côté du comptoir, une statuette de lui, une cigarette à la main.
— Tu sais où tu peux te la mettre, ta statuette ? hurle l’un des convives.
— Assoyez-vous ! Vous avez des bibittes dans l’traîneau ou quoi ? s’énerve Charlotte.
Atsuko s’interpose entre nous et les individus. Les serveurs nous demandent, ainsi qu’aux trois hommes, de quitter les lieux.
Je règle les consommations et on se retrouve tous sur le trottoir. L’un des hommes pose soudainement la main sur l’épaule d’Atsuko,
dont l’œil droit a fini de clignoter. Coup de pied retourné, et l’individu vole à trois mètres de là.
Dans un souffle, les deux autres suivent la même trajectoire. Puis Atsuko s’attaque aux rétroviseurs des véhicules garés le long du trottoir.
Avec précision, son poing s’élève et s’abaisse en cadence comme pour casser des briques.
Les rétroviseurs giclent et atterrissent dans un bruit d’enfer. Aucun de nous ne se risque à l’interrompre.
Alertés par les alarmes des voitures, les gens sortent des bars et des restaurants.
C’est la foire d’empoigne, les coups de poing pleuvent, la bagarre devient générale.
La BAC déboule, et les policiers nous entassent sans ménagement dans leur camionnette, direction le commissariat.
— Vasilissa, je suis désolé. Vous avez quitté votre pays pour me retrouver et, dès la première nuit, vous finissez en prison.
— C’est ton côté enjôleur qui a encore frappé, plaisante Bruno.
— Ne vous inquiétez pas, me rassure Vasilissa. La geôle est aux Russes ce que la grève est aux Français : un rite initiatique.
Installée sur son banc d’infortune, les jambes croisées, ma compagne respire tranquillement.
Un de ses escarpins se balance doucement au bout de ses orteils. Le temps est à ses pieds.
À 5 heures du matin, deux policiers prennent nos dépositions. Une patrouille est partie à la recherche d’Atsuko, sans succès.
Nous sommes libérés à l’heure où Paris s’éveille. Notre joyeuse compagnie, un peu honteuse, juge préférable de se séparer.
Je prends Vasilissa par la main et, pour traverser Paris, me laisse guider par les ondulations de sa robe à fleurs.
De retour à l’appartement, nous nous déshabillons rapidement en abandonnant nos affaires sur le sol.
Nous voulons nous doucher, nous laver de la nuit dernière. La caresse de l’eau nous pousse l’un vers l’autre.
Les mots d’amour ruissellent sur nos corps, des mers se forment au creux de nos bras enlacés, des paysages marins s’esquissent à nos pieds.
Sur la joue de Vasilissa, un grain de beauté dessine un atoll, une terre pour naufragé de la vie.
Ses longs cils balaient l’eau, ses yeux bleus en amande me fixent. Nos corps se mêlent…
On se glisse sous la couette. Vasilissa a la grâce de la Vénus d’Urbino. Je me love dans ses bras. Elle s’endort la première.
Enfin, je ferme les yeux.
C’est tout d’abord un bruissement lointain, une vibration sourde.
Puis un bruit d’enfer, comme les machines de l’Erika lancées à pleine puissance pour échapper au naufrage
sur les côtes bretonnes par un jour de tempête. La baie vitrée vrombit. Vasilissa se réveille en sursaut.
— Qu’est-ce qui se passe encore ?
— Rien, rendormez-vous. Tout va bien…
— Comment ça, tout va bien ? Tout tremble, il y a un bruit terrible. Il est quelle heure ?
— 7 h 30, je crois. L’heure apparemment où le Franprix en bas de l’immeuble se fait livrer.
Bizarrement, les vibrations du moteur du camion correspondent à la fréquence de résonance de la baie vitrée.
J’espère qu’elle ne va pas s’effondrer comme le pont d’Angers.
— Le pont d’Angers ?… Mais qu’est-ce que vous racontez ?
— Le pont d’Angers, en 1850. Des militaires défilaient au pas et l’onde sonore a fait s’écrouler l’édifice.
Deux cent vingt-six morts, quand même.
— Marc, voilà ce qui va se passer. Soit ce bruit s’arrête dans les cinq minutes, soit je fais mes bagages et je rentre en Russie !
Deux minutes plus tard, je parlemente en slip, au bas de l’immeuble, avec le routier.
Il ne connaît pas l’histoire du pont d’Angers, mais il coupe net son moteur. Le bruit ayant enfin cessé, je remonte retrouver ma belle.
Vasilissa dort, des boules Quies dans les oreilles, le traversin cerclant sa tête. Ma tendre ressemble plus à un coton-tige qu’à la Vénus d’Urbino.
Je prends doucement sa main dans la mienne et la regarde dormir. Je l’aime du fond du cœur.
Je me réveille vers 18 heures. Vasilissa n’est plus là. Abandonné au bout de vingt-quatre heures, quelle honte !
Et dire que nous devons nous marier l’année prochaine. Sur son oreiller, un post-it : Marc, la vie à deux pour nous, c’est un non négatif.
Je rentre à Moscou…
Je me lève d’un bond, m’habille en vitesse. J’ai le cœur en miettes. Je dévale les marches de la mezzanine, prends les clés de la voiture.
Sur la porte d’entrée, un autre message : Je vous attends à 20 heures dans notre restaurant de la Galerie Goum, à Moscou, dans 2 semaines.
Venez, nous fauterons ensemble…
Hervé Pouzoullic est l’auteur de deux romans, tous les deux parus aux Editions Anne Carrière :